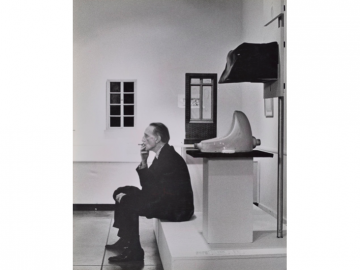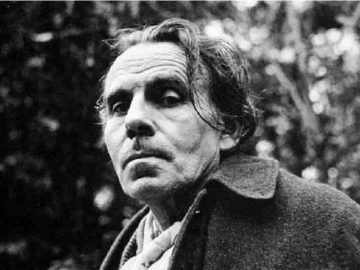L’Absurde comme point de chute (3/3)
III
Plusieurs analogies existent entre les personnages qui peuplent l’univers camusien, de Meursault à Clamence, en passant par Sisyphe, sans oublier Camus lui-même. Nous ajouterons également Niki, personnage central de “La femme des sables”, unfilm deHiroshi Teshigahara, qui nous permettra de nous interroger sur la condition de l’homme face à l’absurdité de son existence. S’il ne propose aucune certitude religieuse ou idéologique, Camus formule des questions. Fondamentalement, il est un homme de la tragédie, cet éternel combat de la mesure contre la démesure. La prise de conscience, l’angoisse que l’homme éprouve lorsqu’il se confronte à sa propre finitude.
Apprendre à vivre avec la mort, voilà peut-être ce qui relie chacun de ces hommes. Un sentiment tragique habite Jean-Baptiste Clamence tout au long de la seconde partie du roman. Une conscience en forme d’électrochoc qui l’oblige à se reconnecter directement avec le réel, loin des frivolités de sa vie parisienne. L’indifférence de cet homme, face à la détresse d’une femme abandonnée, ne sont pas sans nous rappeler l’attitude que Niki avait eu à l’égard de sa charmante compagne. Du reste, la description que Camus fait de la femme sur le pont, évoque cette même sensualité morbide : “De plus près, je distinguai une mince jeune femme, habillée de noir. Entre les cheveux sombres et le col du manteau, on voyait seulement une nuque, fraîche et mouillée, à laquelle je fus sensible.”
Parce qu’il fut incapable de prendre soin de son bonheur, Niki ne s’est pas aperçu que la femme qui vivait à ses côtés portait en elle la vie. Et malgré son appel tardif aux villageois, la petite musique de la vie se transforme en un champ funeste. Nikki vient de sacrifier sur l’autel de son égoïsme, cette femme sublime, la vie, qu’il n’a pas su aimer. L’homme la laisse alors partir auprès des Dieux, se rendant à jamais coupable de son aveuglement. Cette culpabilité pourrait notamment être symbolisée par l’enfant qui regarde brièvement Niki du haut de son trou, dernière image puissante du long métrage. Une condamnation qui s’apparente bien évidemment à celle que connaîtra Clamence pour le restant de ses jours. L’homme dépeint dans “La Chute” a commis cette faute : l’inaction, la passivité et même la fuite, devant cette femme se noyant dans la Seine, tout près de lui. “Il n’est pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir” (Proverbe français). Dès lors, ces deux personnages ne seront plus jamais les mêmes. Leur indifférence face au reste de monde faisant d’eux des coupables pour l’éternité. Il est trop tard pour Niki, comme pour Clamence dont les dernières lignes de “La Chute” s’achèvent ainsi : “Il est trop tard, maintenant, il sera toujours trop tard. Heureusement !”
Le sentiment de devoir revivre sa culpabilité, “il sera toujours trop tard”, permet aux personnages camusiens d’accéder au bonheur. C’est d’ailleurs cette condamnation éternelle qui les oblige à transcender leur existence, autrement dit, à vivre heureux en apprenant à accepter la souffrance quotidienne des jours. Le Mythe de Sisyphe semble illustrer symboliquement cette image de la tragédie humaine. Les pensées de Sisyphe, sa lucidité lorsqu’il redescend de la montage, ne sont-elle pas les mêmes que celles de Niki et Clamence ? Condamnés pour avoir tenté de nier la mort, et donc de mépriser la vie ? Pour n’avoir pas su profiter humblement du présent, du bonheur d’être vivant ? Dans la mythologie grecque, les Dieux obligèrent donc Sisyphe à être heureux pour l’éternité, en prenant lui aussi conscience du sentiment tragique de son existence.
Clamence est donc “heureux” de n’avoir pas su sauver cette femme, sa conscience le condamnant pour le reste de son existence à devoir éternellement revivre ce moment, se souvenir de la mort pour se sauver lui-même. Telle est la définition que l’on pourrait faire du juge-pénitent pour reprendre l’expression de Camus qui accepte le malconfort dans lequel il est plongé, pour vivre heureux. C’est en tout cas la position commune adoptée par Niki, Sisyphe Meursault et Clamence :“Mais ce sont les mêmes qui criaient, qui appelaient déjà sur l’Atlantique, le jour où je compris définitivement que je n’étais pas guéri, que j’étais toujours coincé, et qu’il fallait m’en arranger. Finie la vie glorieuse, mais finis aussi la rage et les soubresauts. Il fallait se soumettre et reconnaître sa culpabilité. Il fallait vivre dans le malconfort.”
Afin de pouvoir accéder à la rédemption, grâce à l’humilité que l’être éprouve face à son existence, Albert Camus décrit ainsi le malconfort : “C’est vrai, vous ne connaissez pas cette cellule de basse-fosse qu’au Moyen Âge on appelait le malconfort. En général, on vous y oubliait pour la vie. Cette cellule se distinguait des autres par d’ingénieuses dimensions. Elle n’était pas assez haute pour qu’on s’y tînt debout, mais pas assez large pour qu’on pût s’y coucher. Il fallait prendre le genre empêché, vivre en diagonale ; le sommeil était une chute, la veille un accroupissement. Mon cher, il y avait du génie, et je pèse mes mots, dans cette trouvaille si simple. Tous les jours, par l’immuable contrainte qui ankylosait son corps, le condamné apprenait qu’il était coupable et que l’innocence consiste à s’étirer joyeusement. Pouvez-vous imaginer dans cette cellule un habitué des cimes et des ponts supérieurs ?”
Bien entendu, la description de cette mise en scène avilissante, dans laquelle l’Homme est asservi à la volonté d’êtres supérieurs, rappelle la condamnation de Sisyphe, obligé quotidiennement à une tâche absurde. Elle rappelle également l’enfermement de Meursault ou encore de Niki, condamnés à être heureux malgré leur souffrance quotidienne, au risque sinon de se condamner une seconde fois. Le malconfort de Clamence est ce cri qui le poursuit. Pour autant, humiliation rime-t-elle avec humilité ? “Avez-vous au moins entendu parler de la cellule des crachats qu’un peuple imagina récemment pour prouver qu’il était le plus grand de la terre ? Une boîte maçonnée où le prisonnier se tient debout, mais ne peut pas bouger. La solide porte qui le boucle dans sa coquille de ciment s’arrête à hauteur de menton. On ne voit donc que son visage sur lequel chaque gardien qui passe crache abondamment. Le prisonnier, coincé dans la cellule, ne peut s’essuyer, bien qu’il lui soit permis, il est vrai, de fermer les yeux. Eh bien, ça, mon cher, c’est une invention d’hommes. Ils n’ont pas eu besoin de Dieu pour ce petit chef-d’oeuvre.”
La dernière partie de cette citation dépasse l’idée qu’une telle condamnation, dans le cas de Sisyphe par exemple, vienne des Dieux. Camus nous livre, non sans violence, une piètre image de notre humanité. Pour l’auteur, il apparaît très clairement qu’aucun Homme est innocent, dès sa naissance. Il serait méchant par nature. Tel un miroir, les souffrances que les hommes infligent désormais à Clamence, condamné à son malconfort, font directement écho au mépris qu’il affichait auparavant à l’égard de l’humanité (ce dandysme dont il faisait preuve ne rappelle -t-il pas avec délice les traits de caractère du personnage mondain décrit par Oscar Wilde dans Le Portrait de Dorian Gray ?). La seule solution reste la confession, un bilan que Clamence comme Camus, semblent vouloir faire, tout deux à l’âge de la quarantaine. Cette épreuve consiste à mesurer le décalage qui pourrait exister entre ses attentes et ses réalisations concrètes, autrement dit accepter ses échecs, ses souffrances, ses faiblesses. Les Hommes seraient fautifs de leurs ambitions, parfois démesurées, s’enchaînant eux-même à leur propre malheur. Clamence devient ainsi la projection des questions que l’Homme se pose sur sa condition, tiraillé par sa volonté de vouloir plus, ce qui au final l’asservit, et sa capacité à aimer sincèrement ce qu’il possède. Par ce chemin, cette chute intérieure, Clamence semble s’avouer la vérité : l’absurdité de toute existence. Désormais, il ne lui reste plus qu’à apprendre à souffrir pour être heureux de vivre. L’image que nous donne Camus du malconfort, cette privation de liberté, semble poser l’une des grandes questions qui parcourent son œuvre : Faut-il renoncer à sa liberté pour accéder au bonheur ?
Le chemin intérieur que parcourt Niki, pourrait en partie répondre à cette interrogation. Comme Clamence, Niki a connu une existence faite de recherches incessantes, qui ne l’ont pour autant pas rendu heureux. Si les Dieux, déguisés en villageois, l’ont condamné par hasard (autre thème cher à Camus), Niki décide de fuir la condition nouvelle dans laquelle il a été jeté. En effet, il tentera de s’échapper une nuit à l’aide d’une corde qui lui permettra de remonter à la surface. Comme nous l’évoquions lors d’un précédent travail, cet épisode n’est pas sans évoquer le mythe de la Caverne de Platon. L’homme enchaîné à sa condition, et obligé de regarder passer des ombres, va se libérer en brisant ses chaînes pour rejoindre la surface. Alors que le héros de Platon accédera à la vérité une fois au sommet de la montagne, la lecture de Hiroshi Teshigahara semble bien différente. Son personnage, que l’audace a libéré, se retrouve face à un soleil voilé, puis sombre et inquiétant qui le plonge dans l’obscurité. Un soleil qui le poursuit et l’écrase, proche de celui décrit à plusieurs reprises par Camus dans l’Etranger. Cette image renforce l’idée d’une condition sans issue et donc sans espoir. Plus tard, au cours de cette scène, Niki s’arrête, perdu dans le désert et happé par des sables mouvants. Il finira par crier à l’aide, et accepter que les villageois viennent le sauver. Ce moment charnière montre que l’homme accepte sa condition, par volonté de vie, même s’il se voit irrémédiablement condamné à retrouver sa misérable existence.
Alors que Niki avait accédé à la liberté, il s’est malgré tout retrouvé désemparé face à l’immensité des choix possibles qui s’offraient à lui. Perdu dans le désert et l’obscurité, tournant en rond, son incapacité à tracer son chemin le condamnera à sa perte. Devant cet échec, il demande l’aide des villageois, au prix de sa liberté, le conduisant à accepter leurs règles. Dans un magnifique passage de “La Chute”, Camus évoque l’incapacité de l’homme a assumer sa liberté : “Autrefois, je n’avais que la liberté à la bouche. Je l’étendais au petit déjeuner sur mes tartines, je la mastiquais toute la journée, je portais dans le monde une haleine délicieusement rafraîchie à la liberté. Vous voyez en moi, très cher, un partisan éclairé de la servitude. Ah ! mon cher, pour qui est seul, sans dieu et sans maître, le poids des jours est terrible. Il faut donc se choisir un maître, Dieu n’étant plus à la mode.”
Camus fait ici référence à la servitude volontaire d’un Homme qui, après avoir écarté Dieu de sa route, chercherait aussitôt à se réfugier dans de nouvelles lois. Il en va peut-être ainsi de toute société, même démocratique, dans l’esprit de Camus. Et c’est par la peur d’être libre de ses choix et donc responsable de ses erreurs que l’homme aime être un serviteur. Coupable, il préfère se condamner. Telle est sa nature, son besoin d’ordre et de hiérarchie. Cette idée se rapproche de la théorie que Etienne de La Boétie exprimait déjà au milieu du XVI ème dans un essai intitulé Discours de la servitude volontaire (De la Boétie, 136-137) : “Pauvres gens misérables, peuples insensés, nations opiniâtres à votre mal et aveugles à votre bien ! Celui qui vous maîtrise tant, n’a que deux yeux, n’a que deux mains, n’a qu’un corps, et n’a autre chose que ce qu’a le moindre homme du grand nombre infini de vos villes ; sinon qu’il a plus que vous tous c’est l’avantage que vous lui faites, pour vous détruire. D’où il a pris tant d’yeux, dont vous épie-t-il, si vous ne les lui donnez ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne les prend de vous? Vous vous affaiblissez, afin de le faire plus fort et roide, à vous tenir plus courte la bride ; et de tant d’indignités, que les bêtes mêmes, ou ne sentiraient point, ou n’endureraient point, vous pouvez vous en délivrer, si vous essayez, non pas de vous en délivrer, mais seulement de le vouloir faire. Soyez résolus à ne plus servir, et vous voilà libres. Je ne vous demande pas de le pousser, de l’ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir, et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre.”
Pour Camus, l’Homme choisit de se rendre volontairement prisonnier des autres Hommes. Il est avant tout, ne l’oublions pas, esclave de lui-même, et de ses passions égoïstes.La théorie de Nietzsche, selon laquelle “Dieu est mort” apparait bien sûr en toile de fond. Malgré sa capacité à avoir triomphé des doctrines religieuses, l’Homme a créé de nouvelles lois pour s’y réfugier, s’y asservir et vivre plus confortablement son existence. Camus fait ainsi parler Clamence : “Mais sur les ponts de Paris, j’ai appris moi aussi que j’avais peur de la liberté. Vive donc le maître, quel qu’il soit, pour remplacer la loi du ciel. Ah ! les petits sournois, comédiens, hypocrites, si touchants avec ça ! Croyez-moi, ils en sont tous, même quand ils incendient le ciel. Qu’ils soient athées ou dévots, moscovites ou bostoniens, tous chrétiens, de père en fils. Mais justement, il n’y a plus de père, plus de règle ! On est libre, alors il faut se débrouiller et comme ils ne veulent surtout pas de la liberté, ni de ses sentences, ils prient qu’on leur donne sur les doigts, ils inventent de terribles règles, ils courent construire des bûchers pour remplacer les églises. Et chaque fois que je le peux, je prêche dans mon église de Mexico-City, j’invite le bon peuple à se soumettre et à briguer humblement les conforts de la servitude, quitte à la présenter comme la vraie liberté.”
Si la conscience de la mort renforce le sentiment de l’absurdité de la vie, l’acceptation de cette faible condition humaine est le seul chemin qui mène au bonheur. Selon Camus, il semblerait que cette recherche effrénée du bonheur, condamne précisément l’Homme à ne jamais le trouver, par son aveuglement quotidien (tel Œdipe, autre héros grec). Comme nous venons de le voir, ces personnages masculins, rendus coupables de n’avoir pas su aimer sincèrement la vie, se trouve dès lors mis au banc des accusés. La mort les condamne à devoir vivre heureux, débarrassés de leur arrogante insatisfaction. Ce renversement sublime, déclenché par une prise de conscience, condamne les antihéros camusiens à s’accomplir quelque soit l’ingratitude de leur nouvelle tache journalière. C’est en parvenant à l’apprécier que l’Homme pourra ainsi accéder au bonheur. Tel est le juge-pénitent qui, en acceptant sa culpabilité, parviendra à retrouver le fil de lui-même. Ainsi, il dominera toujours celui qui vivra dans le mensonge, la peur et l’indifférence. Telle est sa tragique victoire, celle de s’être avoué la vérité. Nous retrouvons ici l’Amor Fati de Nietzsche, tel que nous l’évoquions lors de précédentes recherches : “Vis de telle sorte qu’il te faille désirer revivre éternellement”… chaque instant présent. En acceptant le tragique de son existence, l’Homme pourrait-il se suffire de vivre, simplement libre de penser, même en acceptant une action limitée ?
On retrouve en effet un thème cher à Camus, déjà perceptible dans L’Etranger, selon lequel le bonheur n’est possible qu’en prenant conscience de l’absurdité de notre destin commun. Cette condition permet à l’homme conscient de vivre chaque instant heureux, sans se soucier de devoir vivre éternellement. En filigrane se dessine l’Eternel Retour, un autre concept de Nietzsche que Camus citera tout au long de sa carrière (même lors de son discours de réception du Prix Nobel).Autrement dit, savoir accepter et se satisfaire de sa condition humaine, telle serait la clef du bonheur. Clamence était auparavant projeté dans une existence à l’insatisfaction permanente, le condamnant au cynisme. Grâce l’absurdité de sa nouvelle existence, il fallait imaginer Clamence simplement heureux d’être vivant.
“Sans doute, je faisais mine, parfois, de prendre la vie au sérieux. Mais, bien vite, la frivolité du sérieux lui-même m’apparaissait et je continuais seulement de jouer mon rôle, aussi bien que je pouvais. Je jouais à être efficace, intelligent, vertueux, civique, indigné, indulgent, solidaire, édifiant… Bref, je m’arrête, vous avez déjà compris que j’étais comme mes Hollandais qui sont là sans y être : j’étais absent au moment où je tenais le plus de place.”
CONCLUSION
L’existence de Camus a toujours été marquée par la mort. Dès son plus jeune âge. La présence d’un père absent. Comme une ombre sans contour. Dont il fallait toujours se souvenir. La prise de conscience, violente, brutale, de cette fatalité, la mort, marquera à tout jamais la vie de l’auteur. Il fallait qu’elle advienne la mort. Il fallait l’accepter pour mettre fin à l’innocence. Nous condamnant à vivre enfin, conscient, pour vivre heureux. Tel était le destin de Meursault, Sisyphe, Clamence, Camus et les autres. La mort, intrusive, fit son apparition par hasard. Son caractère définitif fit basculer notre existence, à tout jamais. Notre impuissance face à elle. Désarmé.
Tout fait sens à présent. Ce matin là cette question raisonnée sans doute encore dans son être. Comme une évidence : L’Homme est-il condamné, enchaîné à son passé ? Il fallait apprendre à nous pardonner notre innocence. Pour faire de l’existence une volonté, plutôt qu’un poids. Le Dasein. Prendre pleinement conscience de notre bonheur présent. Celui d’être là. Vivant. Nous n’avions pas d’autre choix, au fond. Il fallait apprendre à sublimer le présent, humblement, car nous n’étions responsables de la mort. Voilà ce que nous sommes : simplement coupable d’être mortels. De devoir souffrir notre condition humaine. Quotidienne. Et puiser en elle la force d’être heureux. Malgré cela. Sachant cela.
C’est ce destin que Camus porte en lui. Il m’avait fallu venir ici pour le comprendre. Telle est ma chute. Dans cette voiture en forme de corbillard. Le 4 janvier 1960. A vive allure et par un froid glacial qui avait déjà pris possession de son corps, face à l’absurdité du monde et dans un sourire éternel, il fallait imaginer Camus heureux.
REFERENCES
PETREY Sandy “The Function of Christian Imagery in La Chute”, Texas Studies in Literature and Language, Vol. 11, No. 4 (Winter 1970), pp. 1445-1454
CELINE Louis-Ferdinand, “Voyage au bout de la nuit”, Paris: Gallimard, (1971), p. 5
BAUDELAIRE Charles, “Les fleurs du mal”, extrait “Spleen”, Paris: Gallimard,(1972), p.106
RAMOND, Charles, “Job, Meursault, Clamence”, Carnets : revue électronique d’études françaises. Série II, nº 12, janvier 2018, p. 29-43
DE LA BOETIE Etienne, “Discours de la servitude volontaire”, vers 1550 GF, ed. Goyard-Fabre, p.136-137
PETITE MUSIQUE CRITIQUE
par Gabriel Maginier